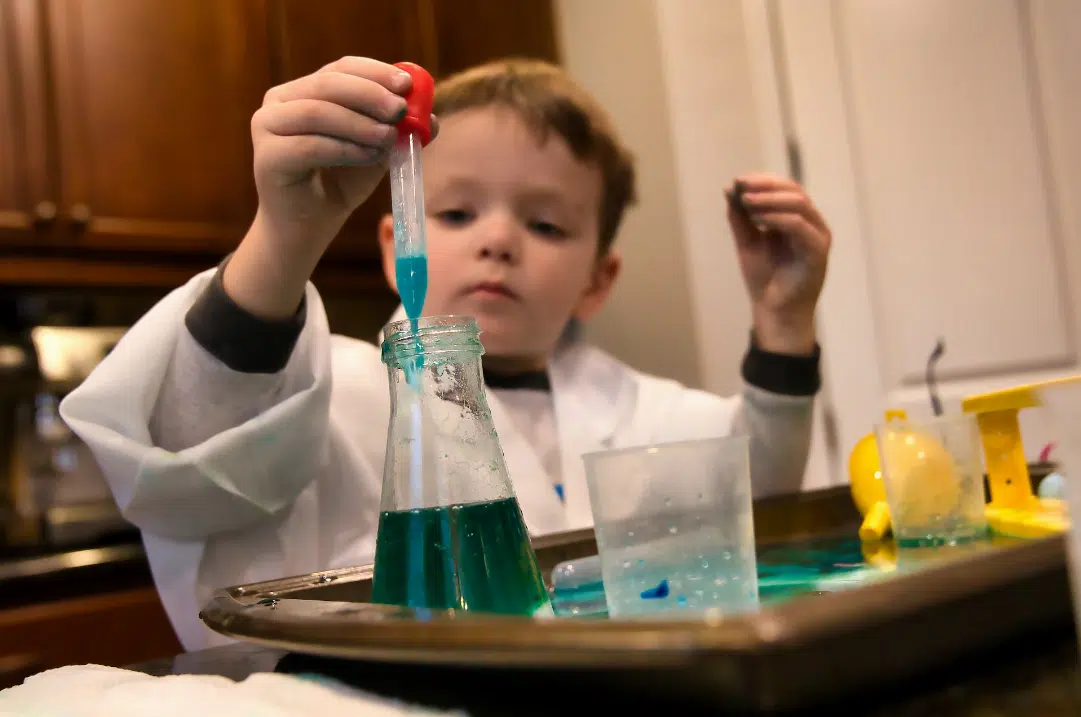En France, la Journée nationale des grands-parents ne figure dans aucun calendrier officiel, contrairement à d’autres célébrations familiales. Pourtant, plusieurs associations militent depuis des décennies pour l’instauration d’une date reconnue, alors même que certaines municipalités organisent déjà des événements dédiés.
Ce contraste entre initiatives locales et absence de reconnaissance nationale met en lumière des enjeux sociaux et intergénérationnels encore peu explorés. Derrière cette journée, se dessinent des problématiques liées à la place, au rôle et à la valorisation des aînés au sein des familles contemporaines.
La journée nationale des grands-parents : mythe ou réalité en France ?
La Journée nationale des grands-parents fait parler d’elle, sans jamais s’imposer officiellement dans les calendriers tricolores. Des associations, des collectifs, des familles la réclament depuis des années, mais l’État reste de marbre. Pourtant, ailleurs, la reconnaissance existe : l’ONU a lancé la journée mondiale des parents le 1ᵉʳ juin, la Pologne et le Canada rendent hommage à leurs aînés chaque année, sans hésiter. En France, deux célébrations distinctes subsistent : la fête des grands-mères en mars, celle des grands-pères en octobre. Rien, cependant, qui réunisse officiellement ces deux piliers familiaux lors d’un même rendez-vous.
La famille, institution centrale, place pourtant les grands-parents sous les projecteurs : près de neuf millions de Français, selon l’INSEE, endossent ce rôle. À Paris comme en province, des événements ponctuels voient le jour : ateliers, conférences, rencontres intergénérationnelles, souvent portés par des collectivités ou des associations comme Grand Mercredi, qui cherchent à mobiliser autour de la question. Ce foisonnement local contraste avec l’absence de reconnaissance nationale. Les discours publics, eux, saluent la transmission et la solidarité entre générations, mais l’acte symbolique, lui, se fait attendre.
Dans les arcanes politiques, la question divise. Certains élus proposent une journée nationale parents-enfants qui rassemblerait toutes les générations, dans une logique de cohésion sociale. D’autres préfèrent s’inspirer de la journée mondiale instaurée par l’ONU. Pour l’instant, le dossier reste ouvert : la France franchira-t-elle le pas, ou choisira-t-elle de rester en retrait face à la dynamique internationale ?
Petite histoire d’une célébration méconnue
La fête des grands-mères ne s’est invitée dans le calendrier français qu’en 1987, sous l’impulsion d’une marque de café. Inspirée des traditions anglo-saxonnes, elle ne bénéficiait pas, à ses débuts, d’un véritable enracinement populaire. La fête des grands-pères, plus récente encore, a vu le jour en 2008, mais peine à s’imposer dans les habitudes nationales. Ni l’une ni l’autre ne figure dans la liste des célébrations officielles, contrairement à la fête des mères ou à la fête des pères, toutes deux reconnues par l’État depuis le siècle dernier.
Ailleurs, le calendrier familial suit d’autres rythmes. En Pologne, les aînés sont honorés depuis les années 1960 grâce à deux journées distinctes en janvier. Au Japon, chaque mois de septembre, “Keirō no hi”, la journée du respect pour les personnes âgées, rassemble familles et collectivités. Le Canada a retenu le mois de septembre pour sa propre journée, tandis que les États-Unis célèbrent la “National Grandparents Day” depuis 1978, portée par la ténacité d’une militante, Marian McQuade.
Voici quelques exemples marquants de cette diversité à travers le monde :
- Europe : la reconnaissance des grands-parents varie fortement d’un pays à l’autre, entre traditions locales et initiatives privées.
- Italie : une journée nationale leur est consacrée le 2 octobre, en lien avec la fête des anges gardiens.
Quant à la journée mondiale des parents, établie par l’ONU en 2012, elle vise à rassembler autour de la famille. Pourtant, la France n’a pas saisi l’opportunité d’officialiser une célébration nationale unifiée pour ses grands-parents. Résultat : chaque pays, chaque région, chaque ville invente ses propres usages, révélant la diversité, et la fragmentation, des regards portés sur les aînés.
Pourquoi les grands-parents jouent un rôle clé dans les familles d’aujourd’hui
Dans de nombreux foyers français, les grands-parents sont devenus des soutiens majeurs, présents à chaque étape de la vie familiale. Leur influence ne se limite pas à la garde des petits-enfants : ils accompagnent, rassurent et transmettent, tout en s’adaptant à l’évolution des structures familiales. La recomposition, les déménagements fréquents, l’éloignement géographique : autant de défis que les aînés relèvent au quotidien, souvent dans la discrétion.
Leur appui prend de multiples formes. Sur le plan financier, ils répondent à l’augmentation du coût de la vie, prêtant main-forte aux jeunes générations. Côté organisation, près d’un tiers d’entre eux assurent régulièrement la prise en charge des enfants après l’école ou pendant les congés scolaires. Mais leur rôle va bien plus loin. La transmission intergénérationnelle, des histoires, des savoir-faire, des valeurs, structure le lien familial et nourrit la mémoire collective.
On peut distinguer plusieurs facettes de cet engagement :
- Solidarité familiale : en période de crise, les grands-parents sont une véritable bouée de secours lors d’épreuves comme une séparation ou une difficulté professionnelle.
- Accompagnement éducatif : forts de leur expérience, ils offrent conseils et recul, parfois à contre-courant des méthodes d’aujourd’hui, mais toujours en quête de bienveillance.
Les épreuves récentes, pandémie, tensions économiques, ont mis en lumière la force de la solidarité intergénérationnelle. Les débats autour d’une journée nationale des parents et enfants en France et au Canada ravivent la discussion sur la reconnaissance de ce rôle unique. Les formes de la famille changent, mais la présence des grands-parents reste un point d’ancrage, à la fois nécessaire et profondément naturel.
Défis et perspectives : quelle place pour les grands-parents dans la société moderne ?
La transformation des familles et le vieillissement de la population placent les grands-parents face à des défis inédits. Leur implication, longtemps confinée à la sphère privée, interroge désormais l’ensemble de la société. L’espérance de vie progresse, mais l’isolement guette de nombreux aînés, surtout lorsque les familles sont éclatées et que les rythmes professionnels des plus jeunes laissent peu de place à la disponibilité.
L’aide qu’ils apportent, qu’elle soit affective ou matérielle, n’est plus systématique. La reconnaissance par les institutions reste inégale : malgré l’ancrage de la fête des grands-mères dans le calendrier, aucune journée nationale ne vient saluer l’ensemble des grands-parents. D’autres pays, comme le Canada ou l’Italie, ont franchi ce cap, interpellant la France sur ses propres choix de société. Parallèlement, la question de la solidarité entre générations s’impose, notamment face à la précarité de certains retraités et à la mutation des dispositifs d’aide à l’autonomie.
Quelques pistes s’imposent pour l’avenir :
- Comment adapter les politiques publiques pour intégrer pleinement les grands-parents dans la vie sociale ?
- Jusqu’où miser sur la solidarité familiale sans négliger l’action des pouvoirs publics ?
Des expériences locales émergent, à Paris ou en Île-de-France, où des associations et des espaces partagés renforcent le lien entre générations. Le débat sur la création d’une journée internationale des grands-parents résonne dans une société en quête de repères. Valoriser ces figures familiales, c’est aussi repenser le vivre-ensemble, à l’heure où chacun cherche, parfois sans le dire, à se raccrocher à une histoire commune.